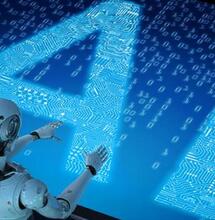Interview de Pierre-Arnaud Chouvy, chercheur en géographie au CNRS

Pierre-Arnaud Chouvy est géographe, chercheur au CNRS spécialisé dans la culture du pavot et du cannabis. Il a effectué de nombreuses missions de recherche sur le terrain dans les pays producteurs, notamment au Maroc et en Afghanistan. Pierre-Arnaud Chouvy fait partie du groupe Prodig (Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique).
Par Olivier F / Photos : Pierre-Arnaud Chouvy
SSFR : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
Pierre-Arnaud Chouvy : Après avoir fait des études de géographie et obtenu un doctorat, je suis devenu chercheur au CNRS spécialisé dans les plantes à drogues, pavot et cannabis, depuis 2002. Je fais partie du laboratoire Prodig, une unité mixte de recherche (UMR) qui regroupe des chercheurs, notamment géographes.
Pourquoi avoir choisi cette spécialisation ?
Plus jeune, je me suis intéressé aux plantes à drogues par l’intermédiaire de lectures anthropologiques. C’est notamment pour cette raison que je me suis intéressé aux drogues en tant que géographe. Mon approche était au départ strictement géopolitique. Ma thèse concernait principalement les facteurs d’émergence de la production d’opium en Afghanistan et en Birmanie. Je me suis ensuite intéressé aux problématiques de développement relatives à l'économie de la drogue, aux contextes agricoles de production, à la prohibition, à la guerre contre la drogue, au rapport entre économie de la drogue et économie de guerre… Je me suis intéressé au départ au pavot à opium dans l’aire asiatique, puis au cannabis à partir du cas Afghan.
Dans une de vos études, vous soulignez l’importance de faire des recherches sur le terrain…
Un chercheur, comme un journaliste, a l’impératif de l’accès au terrain pour voir par lui-même ce qui se passe, y récolter des données par le biais d’entretiens, de mesures, ou même d’observations directes. L’important est d’avoir des données nouvelles. Dans certains cas, personne n’est allé sur le terrain ou si des personnes y sont allées, elles n’ont pas forcément observé les mêmes phénomènes. Mais le terrain seul ne suffit pas car la science se construit pierre par pierre et il faut donc avoir connaissance de ce que ses prédécesseurs et ses contemporains ont fait ou font toujours sur la thématique ou la région en question. Nous devons prendre connaissance des études scientifiques et des rapports des ONG, comme ceux de l’agence de l’ONU mobilisée contre la drogue et le crime, l’ONUDC.
Quels pays producteurs de drogues avez-vous visité dans le cadre de vos missions ?
Pour le cannabis, j’ai visité le Maroc, la Thaïlande, l’Inde, les Etats-Unis, l’Espagne et les Pays-Bas. Pour le pavot, l’Afghanistan, le Pakistan, l’Iran, la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, l’Inde, la Chine et le Vietnam.

Combien de publications scientifiques et de livres avez-vous publié jusqu’à présent ?
J’ai commencé il y a une vingtaine d’années et j’ai publié environ 70 ou 80 articles scientifiques. J’ai aussi publié 4 ou 5 livres en anglais et en français, dont un ouvrage sur les territoires de l’opium et un atlas du trafic de drogue, d’armes, de contrefaçons et de ressources naturelles dans le sud-est asiatique.
On vous présente comme le successeur du chercheur Alfred McCoy…
C’est arrivé, oui. Mais Alfred McCoy est précurseur de la géopolitique des drogues que je ne serai jamais. C’est un historien américain qui a été le premier à s’intéresser aux politiques de l’héroïne dans le sud-est asiatique. Il a notamment enquêté sur les collisions entre le trafic de drogue et les services de renseignement, français et américain.
Y a y-il des chercheurs français qui travaillent sur les mêmes sujets que vous ?
Assez peu. De nombreux chercheurs travaillent sur le trafic, la consommation, l’offre ou la demande. Mais très peu sur la production agricole de drogues. C’est l’une des grandes lacunes de la recherche sur les drogues en France. La grande majorité des études y concernent l’économie française ou européenne des drogues, ainsi que les problématiques relatives à la consommation, notamment les addictions.
Comment préparez-vous vos missions ?
De diverses manières. Avant le développement des réseaux sociaux, je faisais appel aux réseaux existants, surtout celui de l’Observatoire géopolitique des drogues. Je prends contact avec des chercheurs, des journalistes, des experts ou auteurs indépendants. Facebook et Instagram permettent désormais de rentrer en contact avec des producteurs de cannabis dans le monde entier. Mais les réseaux traditionnels restent importants, surtout quand il ne s’agit d’étudier la production d’opium, laquelle fait l’objet de moins de publicité sur Internet.
Êtes-vous en contact avec les autorités des pays que vous visitez ?
La plupart du temps, non. Je travaille sur des problématiques agricoles. Donc, ce qui m’intéresse, ce sont les paysanneries de l’opium et du cannabis. Je travaille très peu sous l’angle de la criminalité. Je ne considère pas les paysans de l’opium et du cannabis comme des criminels, ce qu’ils sont pourtant souvent au regard des différentes législations. Il n’en reste pas moins qu’il est important d’échanger avec les forces de l’ordre pour qui cherche à étudier la prohibition et la guerre contre la drogue. Il y a quelques années j’ai ainsi assisté à une opération d’éradication forcée avec la police thaïlandaise. C’était important de savoir comment ça se passait.
Avez-vous eu des problèmes, agression ou autre, en visitant une plantation ?
Non, je n’ai pas eu de problèmes. Mais je prends la température avant. Parfois, on sent que le moment n’est pas opportun et on doit renoncer. Par exemple, je suis allé dans le nord-est de l’Inde pour enquêter sur la culture du pavot et la production d’opium. Je suis arrivé, sans le savoir, après une opération d’éradication forcée menée par la police et l’armée indienne. L’opération avait eu lieu juste après la visite d’un autre chercheur. Les gens ont donc fait le rapport entre les chercheurs et les éradications et ce n’était à l’évidence pas le moment d’aller sur place. Mais les agriculteurs sont fiers de montrer leurs cultures et leurs productions et une fois la méfiance dissipée, ils vous montrent avec la même fierté leur champ de pavot ou leur champ de cannabis que leur champ de moutarde ou de tomates.

La plupart des agriculteurs ont plusieurs cultures ?
Dans ces pays, on ne peut pas dissocier la culture de pavot ou de cannabis des autres productions agricoles d’une région. Un cultivateur de pavot ne cultive jamais uniquement du pavot. Il a d’autres cultures, notamment pour répartir les risques, climatiques ou répressifs. L’objectif premier des cultivateurs de pavot ou de cannabis est de subvenir à leurs besoins, surtout alimentaires. Ils produisent donc aussi des cultures vivrières et celles de pavot ou de cannabis servent en général à compenser leurs déficits vivriers. En général, les paysans cultivent aussi des céréales, des fruits et des légumes. Ils ont parfois aussi des petits élevages. Mais cela est très variable selon les régions.
Quelles sont les principales évolutions de la culture du cannabis au Maroc ces dernières décennies ?
Dans les années 60, il n y avait que la variété locale qu’on appelait localement le kif. Il était cultivé pour être fumé et non pas transformé en haschisch. Les sommités hachées étaient mélangées avec du tabac noir et fumées dans une pipe appelée sebsi. On cultive encore un peu de kif à fumer mais c’est vraiment marginal. La production de haschisch, elle, s’est développée progressivement après le passage des hippies au Maroc. Les superficies cultivées en cannabis ont augmenté jusqu’au début des années 2000. La production de haschisch, commerciale et à visée exportatrice, a changé beaucoup de choses. Elle a provoqué une extension puis une intensification de la production, et la priorité a été donnée à la quantité plutôt qu’à la qualité. Si le kif à fumer était cultivé uniquement pour la consommation locale, le haschisch, lui, était principalement produit pour l’export.
Il y a eu ensuite l’arrivée des hybrides…
Dans les années 2000 / 2010, il y a eu une crise du haschisch, suite au développement des cultures de cannabis en Amérique du Nord et en Europe. Le haschisch marocain a subi un revers avec cette concurrence. C’était une crise de qualité, de réputation. C’est à ce moment là que les hybrides modernes, originaires d’Espagne ou des Pays-Bas, ont été introduits au Maroc. Les superficies cultivées avaient déjà été largement réduites mais les rendements élevés des hybrides, systématiques irriguées, ont sans aucun doute permis de compenser, au moins en partie, la diminution de la production. Contrairement au kif, maintenant aussi appelé beldia, les variétés modernes ont aussi des taux de THC plus élevés.

Quelle est la superficie totale de la culture du cannabis au Maroc ?
La superficie a été estimée par les Nations unies jusqu’à 130 000 hectares. C’était en 2003. Actuellement la surface est estimée à 47 500 hectares. Le problème est que l’estimation ne varie pas d’une année sur l’autre. Elle est toujours de 47 500 hectares. Cette estimation n’a pas bougé depuis 10 ans et elle interroge. Il y a forcément des variations d’une année sur l’autre. En me basant sur mes voyages dans le Rif depuis 2004, je peux confirmer que les superficies cultivées ont diminué mais je ne peux pas quantifier cette réduction.
Le Maroc vient de créer son Agence du cannabis. La nouvelle loi autorise le cannabis dit « thérapeutique » mais avec une limitation à 1 % de THC, il s’agit plus de chanvre « bien-être ». Pensez-vous que cette nouvelle loi sera bénéfique aux cultivateurs ?
Globalement, non. Il n’y a d’ailleurs pas de cannabis thérapeutique ou récréatif. Il y a des usages thérapeutiques ou récréatifs du cannabis. D’où l’aberration de cultiver des variétés riches en CBD mais sans THC, après des décennies passées à augmenter les taux de THC et diminuer les taux de CBD des variétés dites récréatives. Sinon, au Maroc, quelques cannabiculteurs ont obtenu une licence pour cultiver mais ça reste à l’état de projet. Ils ne cultivent pas le kif traditionnel mais des variétés importées. Pour moi, c’est une aberration. Parce que le kif contient du CBD, qu’il peut être cultivé sans irrigation et qu’il est adapté aux sols et au climat de la région. Qui plus est, la conservation de la variété kif est déjà menacée par l’introduction massive d’hybrides destinées à la production de haschich. Et maintenant, ce sont de nouvelles variétés hybrides qui sont introduites dans le Rif pour la production de cannabis dit thérapeutique, accentuant donc le risque d’altération du kif par introgression. Enfin, cultiver des variétés hybrides qui doivent absolument être irriguées implique de puiser dans les aquifères de la région. Dans le contexte de changement climatique que l’on connaît, ce n’est bien sûr pas idéal et cela risque fort de poser problème à plus ou moins court terme, lorsqu’il n’y aura plus ni kif ni eau.
Consultez toutes le publications scientifiques de Pierre-Arnaud Chouvy sur son site www.geopium.org